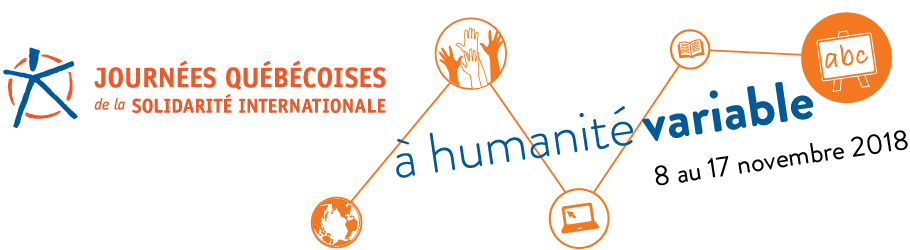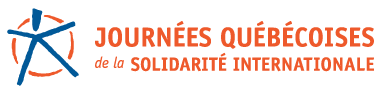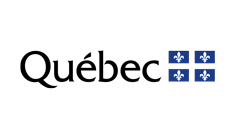Aujourd’hui la diversité ethnoculturelle au Québec n’est plus à prouver, surtout dans les centres urbains tels que Montréal. On peut donc facilement s’imaginer que les écoles francophones, lieux principaux d’éducation pour les jeunes issu-e-s de l’immigration, sont adéquatement équipées en ressources humaines pour répondre aux besoins liés à cette diversité. Pourtant, les défis restent multiples : un personnel scolaire qui reflète peu le corps étudiant, des situations de discrimination et d’intimidation qui passent inaperçues, des familles qui hésitent à s’impliquer au sein de l’école, la « barrière de la langue » trop souvent utilisée comme justification pour une communication limitée avec les familles ne sont que des exemples de problématiques actuellement vécues au sein de nos écoles.
Alors comment se vit réellement la diversité dans nos écoles ? Comment s’assurer que nos jeunes s’y sentent accueillis et en sécurité ? Comment favoriser leur épanouissement et leur réussite ? Comment l’école peut-elle former de jeunes citoyennes et citoyens solidaires ?
Autant de questions auxquelles j’ai voulu répondre ici, en faisant appel à mes expériences en tant qu’intervenante communautaire scolaire, mais aussi en tant que mère monoparentale d’une élève noire qui fréquente une école primaire publique à Montréal.
LES DÉFIS DE LA DIVERSITÉ DANS NOS ÉCOLES
La relation famille-école
À travers mon expérience à Montréal, je me suis rendu compte que la relation famille-école est souvent complexe. En arrivant dans mes écoles d’affectation majoritairement fréquentées par des familles immigrantes et allophones, une réalité me frappe : le manque de représentativité au sein du personnel scolaire. En effet, la diversité des élèves n’y est pas du tout reflétée, car mis à part le
Service de garde et de rares spécialistes, le reste du personnel est plutôt d’origine canadienne-française et blanc.
Est-ce un problème en soi ? Faut-il absolument être d’origine srilankaise pour comprendre les besoins d’une élève qui parle le tamoul à la maison ? À mon avis, pas forcément. Toutefois, il n’en demeure pas moins qu’une bonne compréhension du milieu et des réalités complexes des familles devrait être un minimum requis pour travailler dans ces communautés. Or, j’ai pu voir qu’une grande majorité du personnel vivait hors du quartier, parfois même dans des banlieues assez reculées. Beaucoup étaient loin de comprendre les réalités socio-économiques de leurs élèves, et les difficultés qui perduraient même plus de cinq ans après avoir immigré. Par exemple, plusieurs parents occupaient deux emplois pour arrondir les fins du mois, et n’étaient pas en mesure de suivre de près le cheminement scolaire de leurs enfants. Ignorant cela, le personnel enseignant se plaignait souvent de la faible réactivité des parents : « Ces parents-là n’ont rien à faire de l ’éducation de leurs enfants, cela ne sert à rien de leur envoyer des communications ! ».
Confuse, je cherchais constamment à expliquer à mes collègues que l’immigration, ce n’est pas un simple déménagement. Comment leur faire comprendre que beaucoup de parents, encore très attachés à leur pays d’origine, ne sont partis que pour offrir une éducation de qualité à leurs enfants ? J’essayais de susciter cette réflexion à travers des conversations individuelles, des activités thématiques, mais la tâche était ardue. Beaucoup n’avaient pas conscience de leurs propres idées préconçues, persuadés que leurs voyages fréquents dans le Sud et leur appréciation de certains aspects folkloriques de différentes cultures étaient des gages de leur ouverture sur le monde.
Avec les parents, j’en apprenais beaucoup. Ils me confiaient la raison de leur hésitation à s’impliquer et de leur méfiance vis-à-vis de l’école : ils avaient l’impression que l’école accueillait leurs enfants, mais ne voulait rien savoir d’eux. Au nom de la sécurité et de l’autonomisation de leurs enfants, les portes de l’école leur étaient fermées, sauf lorsque l’équipe avait besoin de bénévoles. Difficile de développer un sentiment d’appartenance envers une institution qui nous retire toute agentivité ! Cette relation difficile entre l’école et les familles se répercutait bien sûr sur la réussite des élèves puisqu’elle influençait même les attentes du personnel enseignant envers eux.
La relation personnel-élèves
En ce qui concerne la relation du personnel avec les élèves, elle aussi demeure complexe. En effet, surtout en milieu allophone, les enseignantes et enseignants se préoccupent davantage de la maîtrise du français, car à leurs yeux, il s’agit là du chemin obligatoire qui mènera ces jeunes vers leur intégration effective et complète dans la société québécoise. Paradoxalement, c’était là, la bataille la plus difficile pour la francophone que je suis. Je me sentais moi-même presque agressée par les multiples pancartes dans les couloirs rappelant : « C’est en français que ça se passe ici ! ». Sans compter que lorsque par inadvertance les élèves laissent échapper des mots dans d’autres langues, ils se font aussitôt réprimander, y compris dans leurs conversations informelles avec leurs pairs. Quoique ce ne soit pas la méthode que j’aurais privilégiée pour développer l’amour d’une langue auprès des enfants, je comprends presque l’intention derrière. Par contre, quand je me faisais surnommer la "petite diablesse" parce que j’avais eu l’audace d’envoyer des communications bilingues aux parents pour les inviter à un cours de francisation, là j’avais plus de mal à comprendre.
Ainsi, dans ce contexte, le personnel enseignant s’attelle à réaliser deux tiers de la mission de l’école québécoise, à savoir « instruire et qualifier », souvent au détriment de « socialiser ». D’ailleurs, leur charge de travail est telle que « socialiser » se limite souvent à faire la discipline, parfois de manière discriminatoire, et particulièrement envers les petits garçons, qui au moindre écart suscitent des réactions disproportionnées du personnel. J’avais été choquée une fois en entendant les propos d’une secrétaire au sujet d’un élève de maternelle d’origine maghrébine, qu’elle avait qualifiée de « futur terroriste ». Peu importe le comportement d’un enfant de cinq ans, je trouve inacceptable qu’un membre du personnel se permette de tenir de tels propos dans un espace professionnel.
Bref, au risque de caricaturer, le temps est tellement consacré au développement de la capacité à lire, à écrire, à calculer et à discipliner, qu’il n’en reste plus pour préparer les élèves à devenir des citoyennes et citoyens responsables et solidaires.
La relation entre élèves
Au primaire, j’ai pu remarquer la capacité des élèves à développer des affinités assez rapidement selon leurs intérêts communs peu importe leurs origines. Toutefois, comme les relations humaines ne sont pas à l’abri d’un conflit, il arrive que certains élèves vivent des situations d’intimidation ou d’exclusion pour des raisons liées à leurs différences réelles ou perçues.
S’il est vrai que les écoles envoient des messages clairs de tolérance zéro à la violence et à l’intimidation, le personnel est souvent peu outillé d’abord pour les détecter et ensuite pour y répondre concrètement. Par exemple, les commentaires racistes, plus insidieux, peuvent facilement passer inaperçus, considérés alors comme de simples « chicanes de jeunes ». Parfois, ce type de violence verbale est balayé d’un revers de la main, ou réglé individuellement, au lieu d’être utilisé comme occasion d’apprentissage pour l’ensemble des élèves.
Je pense notamment au jour où ma fille, en maternelle, m’a raconté qu’une élève avait refusé de jouer avec elle en lui disant qu’elle était « allergique à la couleur de sa peau ». J’ai alors été étonnée de n’avoir reçu aucune communication de la part de son enseignante. Pour moi, cet incident représentait de la violence verbale au même titre que des menaces, surtout compte tenu de l’effet que cela pouvait avoir sur l’estime de soi. Déjà à 5 ans, ma fille avait à plusieurs reprises pris conscience que sa peau noire pouvait susciter chez certaines personnes des réactions négatives. Il fallait donc absolument aborder le problème. Après quelques tentatives pour la rencontrer, l’enseignante bien intentionnée mais débordée, m’avait reçue et m’avait expliqué les mesures qu’elle avait prises pour régler le problème. Elle m’a aussi confié qu’en 20 ans d’enseignement, elle n’avait jamais eu à faire à une telle situation, ce qui m’a emmenée à lui parler de mon travail et des avantages d’intégrer les valeurs des droits humains dans la pratique éducative. Elle m’a ensuite invitée à animer une activité sur l’inclusion, et restait ouverte lorsque j’avais des suggestions de ressources à partager avec la classe, telles que de la littérature jeunesse sur l’estime de soi. Nul besoin de préciser que mon cœur de maman africaine vivant au Québec a été marqué à jamais par cette belle expérience.
UNE APPROCHE FONDÉE SUR LES DROITS HUMAINS COMME PRATIQUE ÉDUCATIVE
Alors, devant ce beau bilan que faire ? Évidemment, tout n’est pas gris dans nos écoles ! J’ai eu la chance de côtoyer des enseignantes et enseignants, des travailleuses sociales, des techniciennes en éducation spécialisée, des psychoéducatrices, des orthophonistes et des conseillères pédagogiques hors pair. Souvent avec très peu de moyens et une tâche ardue dans ces milieux aux multiples défis, ces personnes déterminées collaboraient pour fournir aux familles une aide plus que précieuse. J’ai été témoin à plusieurs reprises du suivi psychosocial, de l’écoute, du soutien scolaire et du dépannage alimentaire d’urgence - car oui, des enfants qui ne mangent pas à leur faim, ça existe à Montréal ! - que ces personnes offrent aux familles, dans un climat de coupures budgétaires qui menace leur présence dans les écoles. Tout cela a réellement ravivé le respect que j’avais au départ pour l’école publique québécoise.
Je ne pense pas qu’une seule solution suffise à se débarrasser de tous les défis décrits ici. Toutefois, mon expérience en éducation aux droits humains auprès de jeunes et d’adultes au Sénégal m’a confirmé les avantages d’adopter une approche fondée sur les droits humains dans toute pratique éducative. En se fixant comme objectif la réalisation de tous les droits humains, une telle approche emmène les membres du personnel à reconnaître leurs responsabilités auprès des apprenantes et apprenants. Parallèlement, elle nécessite la participation active de chaque individu dans leurs propres processus d’apprentissage et les emmène à intégrer les valeurs des droits humains dans leur quotidien. Elle repose sur six éléments : la participation, les liens avec les droits, l’autonomisation, la non-discrimination, l’égalité et la responsabilisation, regroupés sous l’acronyme PLANER (1). Pour intégrer une telle approche, les membres du personnel doivent se poser un certain nombre de questions lors de la planification de leurs activités avec les jeunes :
![]() Qui sont nos élèves ? Comment encourager la participation de tous et toutes ? (Participation)
Qui sont nos élèves ? Comment encourager la participation de tous et toutes ? (Participation)
![]() Quels principes et valeurs des droits humains sont à considérer ? Comment intégrer ces valeurs dans la pratique ? (Liens avec les droits)
Quels principes et valeurs des droits humains sont à considérer ? Comment intégrer ces valeurs dans la pratique ? (Liens avec les droits)
![]() Quelles sont les forces des élèves ? Quelles connaissances ou compétences ont-ils besoin de renforcer ? Comment utiliser les forces des uns pour appuyer les autres ? (Autonomisation)
Quelles sont les forces des élèves ? Quelles connaissances ou compétences ont-ils besoin de renforcer ? Comment utiliser les forces des uns pour appuyer les autres ? (Autonomisation)
![]() Quels élèves pourraient être exclus ou discriminés ? Par qui ? Comment prévenir cela ? (Non-discrimination et Égalité)
Quels élèves pourraient être exclus ou discriminés ? Par qui ? Comment prévenir cela ? (Non-discrimination et Égalité)
![]() Quelles sont mes obligations en tant que membre du personnel ? Quelles sont les droits et devoirs des élèves ? Comment leur faire connaître leurs droits et leurs devoirs ? (Responsabilisation)
Quelles sont mes obligations en tant que membre du personnel ? Quelles sont les droits et devoirs des élèves ? Comment leur faire connaître leurs droits et leurs devoirs ? (Responsabilisation)
Concrètement, ce type de questionnement peut par exemple emmener une enseignante à fixer des règles de conduite avec ses élèves, à définir le contenu de ses cours à partir de leur vécu, à changer la disposition de sa classe pour répondre à un besoin particulier d’un élève, etc. Les possibilités sont multiples ! Une chose reste certaine, l’intégration d’une approche fondée sur les droits nécessite forcément une remise en question des croyances, des privilèges et des pratiques d’enseignement axées sur le mode de « l’expert ». Dans ce contexte, l’apprentissage est mutuel et l’enseignante doit être prête à poser les bonnes questions plutôt que de chercher à donner les bonnes réponses.
Equitas et le Haut-Commissariat aux Droits de l’Homme définissent l’éducation aux droits humains comme « (…) l’acquisition ou le renforcement de compétences nécessaires pour appliquer les droits de l’homme de façon pratique dans la vie quotidienne, le développement des valeurs, le renforcement des attitudes et des comportements qui font respecter les droits de l’homme et les mesures, ainsi que l’adoption de mesures permettant de défendre et de promouvoir les droits de l’homme. » (2) Il ne s’agirait donc pas seulement d’instruire ou de qualifier, mais bel et bien de former des adultes capables de vivre en société, au Québec ou ailleurs, tout en respectant les droits de tous et toutes.
Pour ma part, ce qui me passionne le plus dans mon travail, c’est que j’en apprends autant des expériences des participantes et participants qu’ils n’apprennent des miennes. Et je suis convaincue que si nos écoles étaient à l’écoute des expériences des élèves, et qu’elles s’attelaient à préparer des jeunes à vivre dans le monde, alors les séjours dans le Sud, qui ne sont pas à la portée de tous et toutes ne seraient pas la voie privilégiée pour renforcer la solidarité internationale, elle se développerait ici-même, à la maison !
L’autrice s’exprime ici à titre personnel.
Crédit photo : École élémentaire Mathieu-da-Costa
Notes
(1) Equitas. (2017). Guide d’action Andandoo pour une meilleure participation citoyenne des jeunes et des femmes au Sénégal. Pages 171-175.
(2) Equitas et Haut-Commissariat aux Droits de l’Homme (2011). Évaluer les activités de formation aux droits de l’homme. Page 9.